Par André Comte-Sponville
Dans un entretien mené en 2010 pour la sortie de son
essai Le goût de vivre, André Comte-Sponville se confiait avec tendresse sur la
mort de sa mère, tout en ouvrant un chemin vers le bonheur.
Le philosophe revient dans cet entretien sur les raisons
intimes qui l’ont naturellement poussé vers la philosophie, «bonne mère» auprès
de laquelle il a pu tracer un chemin de vie menant à la «sagesse vraie».
À la question de savoir si, en terminale, la découverte de
la philosophie a changé sa vie, le philosophe répond que la celle-ci lui a
enseigné la joie de vivre, en lui permettant pour la première fois de concilier
vérité et bonheur.
«S’agissant non plus maintenant de ma vocation
d’écrivain, mais de ma vie, ça s’est passé plus progressivement – quoique dès
la classe de terminale, pour moi ce qui s’est joué en philosophie, c’est l’idée
que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble.
Pour des raisons biographiques sur lesquelles je ne veux
pas m’étendre, il se trouve que ma mère était dépressive, très malheureuse.
Elle vivait dans une espèce de monde illusoire,
fantasmatique, un théâtre qu’elle se faisait à elle-même – si bien qu’elle
n’était vraie, au fond, que lorsqu’elle était malheureuse.
Je me souviens, quand elle est morte, elle s’est suicidée
– mon frère m’a appelé pour m’annoncer que notre mère venait de se suicider, on
était adultes depuis longtemps – je me suis dit :
«Tout était faux en elle, sauf le malheur».
Et ses seuls moments de vérité étaient des moments
d’abîme, des moments de malheur, de pleurs.
Et donc j’avais fini par associer la vérité avec le
malheur, et j’avais le soupçon que toute joie était factice.
Et puis, je découvre la philosophie, notamment la
philosophie grecque, et je découvre qu’il peut y avoir une vraie joie, un
rapport joyeux à la vérité.
C’est pourquoi il m’arrive de dire que la philosophie
grecque a été ma «bonne mère», un peu au sens que Melanie Klein donne à
l’expression, au sens où la philosophie, spécialement la philosophie grecque,
m’a montré que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble – et qu’à
l’inverse, c’est l’illusion qui rend malheureux.
Lire aussi : Nietzsche, homme malade et enfant joueur
(Sylvain Portier)
Nietzsche
D’où le thème que j’évoquais dans mon premier livre, Le
traité du désespoir et de la béatitude, qui est l’idée que nous n’aurons de
bonheur qu’à proportion du désespoir que nous serons capables de supporter, et
que l’espérance au contraire nous voue au malheur, puisqu’elle est toujours
déçue.
Elle nous voue à la crainte pendant qu’on espère, et
presque inévitablement à la déception une fois que l’espoir ne s’est pas
réalisé, ou pire peut-être, qu’il s’est réalisé.
Ça, c’est une belle formule de Bernard Shaw qui disait :
«Il y a deux catastrophes dans l’existence.
La première, c’est quand nos désirs ne sont pas réalisés.
La seconde, c’est quand nos désirs sont réalisés».
Alors là, nous sommes très près du monde de Schopenhauer,
finalement.
C’est l’illusion qui rend malheureux, c’est l’espoir qui
rend malheureux.
Quand mon premier livre est paru, j’ai reçu quelques mois
après la lettre d’un psychanalyste, que je ne connaissais pas du tout, un
lecteur, qui me disait qu’il était tout à fait d’accord avec moi, parce que,
disait-il :
«Je constate avec mes patients que l’espoir est la
principale cause de suicide.
On se tue par déception».
Et en effet, des années plus tard et après un parcours
compliqué, en quelques jours ma mère s’est suicidée parce que la vie n’a pas
cessé de la décevoir.
Et bien ce que les Grecs, ce que la philosophie grecque
nous montre, c’est que la vie ne nous déçoit que dans la mesure où on lui
demande d’être autre chose que ce qu’elle est – qu’au contraire, si on accepte
la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire si on aime la vie, il n’y a plus de
déception.
C’est pourquoi la vraie sagesse est celle de Montaigne
qui, à l’extrême fin des Essais, conclut, si l’on peut dire, en écrivant
simplement :
«Pour moi donc, j’aime la vie».
Eh bien voilà, c’est la sagesse vraie.
Mais pour aimer la vie, encore faut-il cesser de lui
demander d’être autre chose que ce qu’elle est.
Lire aussi : Spinoza : l’esprit et le corps (Daniel
Guillon-Legeay)
Quand j’étais petit, je m’étais cogné je ne sais où, et
je me suis mis à pleurer parce que j’avais très mal.
Et ma mère était là près de moi – c’était une mère très
aimante, fragile, mais très aimante – et m’a dit, bizarrement, car ce n’est pas
le genre de réaction qu’elle avait habituellement :
«Mais écoute, tu ne peux pas avoir mal, je suis tout près
de toi et je ne sens rien».
Je savais pertinemment que je me faisais avoir, qu’il y
avait une espèce d’escroquerie dans ce propos ; et en même temps, c’est une
définition de la solitude : c’est-à-dire que quelqu’un se cogne, et ceux qui
sont le plus près de lui, même ceux qui l’aiment passionnément comme c’était le
cas de ma mère, n’ont pas mal à sa place.
Et bien la solitude, c’est ça, et c’est une dimension dont
on n’a pas parlé.
Toute vie est solitaire en quelque chose – et non pas
isolée, on ne vit pas tout seul.
Mais vous savez ce que dit Pascal dans Les Pensées :
«Nous mourons seuls».
Ça ne veut pas dire que nous mourrons isolés dans une
pièce où il n’y aura personne, non – au XVIIe siècle on n’est jamais seul quand
on meurt : il y a toujours le curé, le médecin, les amis, la famille…
Non, non, mais nous mourons seuls parce que personne ne
peut mourir à notre place.
Et bien pour la même raison, nous vivons seuls, parce que
personne ne peut vivre à notre place.
Et quand ma mère me disait : «Je suis tout près de toi et
je ne sens rien», ça voulait dire au fond «Je ne peux pas avoir mal à ta
place».
Si bien que dans cette formule assez étrange et qui
m’étonne encore aujourd’hui de sa part, elle m’apprenait une vérité
essentielle, qui est la vérité de la solitude.
Ce n’est pas le contraire de l’amour, mais là encore il
faut prendre les deux ensemble, parce que l’amour n’est pas le contraire de la
solitude, c’est deux solitudes qui se rencontrent, qui se saluent, comme disait
Rainer Maria Rilke, et qui s’inclinent l’une devant l’autre.»
Lire aussi : Roland Barthes : le plaisir du texte
Roland Barthes
……………..
André Comte-Sponville, né le 12 mars 1952 à Paris, est un
philosophe français. Docteur et agrégé en Philosophie, ancien élève de l'Ecole
normale supérieure, il fut maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne
jusqu'en 1998 et membre du Comité consultatif national d'éthique de 2008 à
2016.
Auteur de très nombreux ouvrages, il est lauréat en 1996
du Prix La Bruyère de l'Académie française pour son Petit traité des grandes
vertus traduit en 24 langues.
Il a dernièrement publié Du tragique au matérialisme (et
retour) (éd. PUF, 2015) et C'est chose tendre que la vie (entretiens avec
François L'Yvonnet, éd. Albin Michel, 2015).
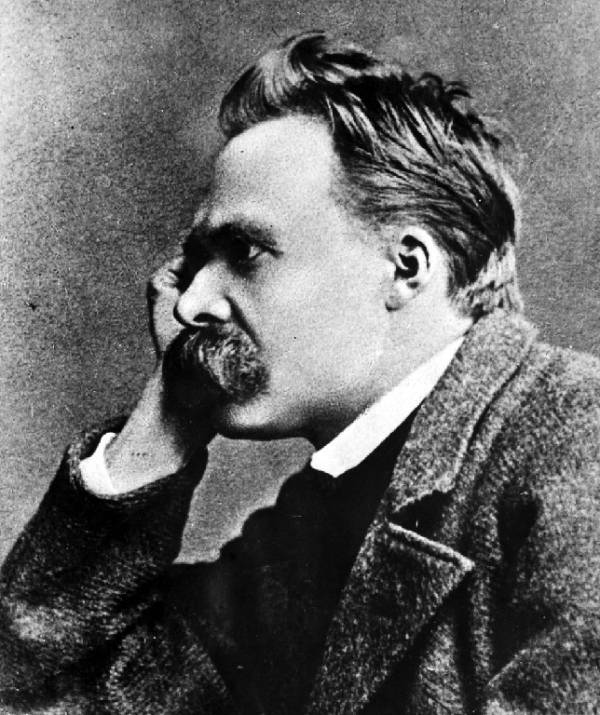


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Votre commentaire est le bienvenu à condition d'être en relation avec le sujet - il sera en ligne après accord du modérateur.
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.